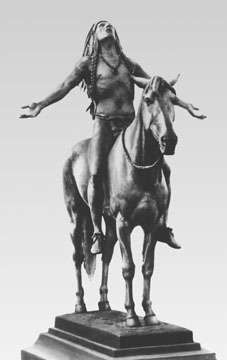Varennes a toujours eu un problème avec son côté droit : quand il était plus jeune, il avait souvent des frayeurs inexpliquées qui venaient de sa droite, était-ce dû à un petit accident qu'il avait eu étant poulain et qui lui a laissé une cicatrice sur la paupière droite ? Possible ... Quoi qu'il en soit, le côté droit lui pose toujours plus de problème : il s'incurve mal, s'étend mal, s'engage mal, a tendance à se raidir et à passer au dessus de la main lorsqu'on tourne à droite. De même, alors que le contact sur les rênes au monté, devrait être égal des deux côtés, le cheval (comme beaucoup de chevaux d'ailleurs) semble toujours "raccroché" à ma main gauche et fuyant la main droite. Evidemment, tout ceci ne fait que mettre en évidence le problème de fond auquel tout cavalier est confronté, et que représente l'inflexion naturelle du cheval.
Le but de ce billet n'est pas de recenser tous les symptômes de l'inflexion naturelle du cheval et d'énumérer leur résolution, mais plus simplement, de faire un petit retour sur expérience de quelques exercices que j'ai pu mettre en place à mon humble niveau pour travailler le redressement du cheval.
Varennes, après un peu plus d'un an de collaboration, est maintenant rôdé aux exercices de 2 pistes en épaule en dedans, cession à la jambe, mais un peu moins aux travers et renvers, ces formes d'appuyer demandant plus d'effort au chevaux, on les abordes dans un second temps. Certes, je les demandais de temps en temps, mais sans vraiment en retirer de bénéfice, autre que le maigre intérêt de la satisfaction d'avoir pu les réaliser (mal sans doute) . Cette petite digression n'est pas si inutile, et on comprendra pourquoi dans ce qui suit je pense.
Ainsi, ce problème de refus de la rêne droite m'apparaissant comme un obstacle perpétuel à notre bonne progression (dans tous les sens du terme), je décidais récemment de tenter d'y remédier, un peu en tâtonnant j'avoue. Je commençais donc bêtement par lui imposer un contact plus franc sur la rêne droite, à main gauche, tout en lui laissant carte blanche de la main gauche, fort de l'expérience que j'avais déjà eu avec Gypsie à ce sujet (cf
Cession de la mâchoire et géométrie). Aussitôt, le cheval s'en trouva gêné et, comme à son habitude, fuyant le contact, orienta sa nuque vers la droite et rejeta son poids sur l'épaule gauche. Evidemment, pour le garder sur la piste, j'appliquais ma jambe intérieure, et le mouvement se rapprochait alors du renvers (épaules légèrement à l'intérieur, pli à l'extérieur et hanches à la piste.
En procédant par petites touches de la main gauche (de petites vibrations) et tout en conservant un contact constant sur la rêne droite, je constatais petit à petit que le contact s'améliorait à droite, et allant même jusqu'à ce que le cheval se redresse, puis inverse même le pli de nuque vers l'intérieur. Je pouvais alors sentir le cheval s'en remettre plus franchement à ma main droite, tout en pouvant conserver une rectitude correcte. Comme par miracle, je trouvais également un meilleur engagement des postérieurs, une meilleure aisance dans le mouvement en avant, et une impulsion plus franche.
Les 2/3 sorties qui ont suivi cette séance furent des balades essentiellement au pas, mais où je m'attachais à obtenir le fameux contact constant sur les deux rênes en toutes circonstances, et en terrain varié. Là encore, j'étais surpris de la mobilité que développait le cheval, et du coeur qu'il mettait à l'ouvrage. Je mettais cela sur le compte de la meilleure rectitude qui engendrait un fonctionnement des plus harmonieux dans le dos et une poussée des postérieurs sans doute mieux répartie (j'ai toujours supposé que le cheval avait plus de difficulté à s'incurver à droite, et à se propulser du postérieur gauche).
Petit à petit, en surveillant ce fameux contact égal, j'ai trouvé que le cheval se musclait plus harmonieusement et que les différents problèmes évoqués à main droite se résorbaient.
Ce type de travail m'a rappelé les fameuses aides diagonales évoquées dans les bouquins du Marechal Lhotte, et je décidais de pousser un peu plus loin leur usage en mettant au point un exercice les mettant en oeuvre. Il s'agissait de demander au cheval d'amorcer un tournant sur des aides diagonales. Ainsi, pour tourner à gauche, j'avançais ma hanche gauche, appliquais ma jambe gauche légèrement en retrait de la sangle, puis déplaçais mon couloir de rênes vers la gauche en utilisant essentiellement la rêne droite en direction du postérieur gauche. Cette combinaison d'aides a tendance à altérer le mouvement en avant, mais aussitôt que le cheval amorçait son tournant, je revenais à une rêne d'ouverture gauche, et demandais plus d'activité en appliquant ma jambe droite légèrement en arrière de la sangle également. Cet exercice fût très bénéfique tant du point de vue du rassembler, que du développement des allures, et c'est pourquoi je décidais de l'inscrire à toutes mes séances de travail en carrière.
Aujourd'hui, Varennes est de plus en plus familier avec les aides diagonales et je peux de plus en plus facilement le diriger d'une seule main, en utilisant une sorte de rêne d'appui. En balade, je m'amuse à déplacer ses épaules pour le mener plus précisément sur une trajectoire donnée du chemin, et c'est très efficace.
Un nouveau code s'est mis en place et la décontraction dont il témoigne de plus en plus régulièrement me montre que nous sommes sur la bonne voie. J'utilise de moins en moins la rêne intérieure et de plus en plus les aides diagonales extérieures.
 . Attention aussi à ce qu'il ne se mette pas trop sur les épaules et qu'il ne s'emmêle pas les crayons.
. Attention aussi à ce qu'il ne se mette pas trop sur les épaules et qu'il ne s'emmêle pas les crayons.